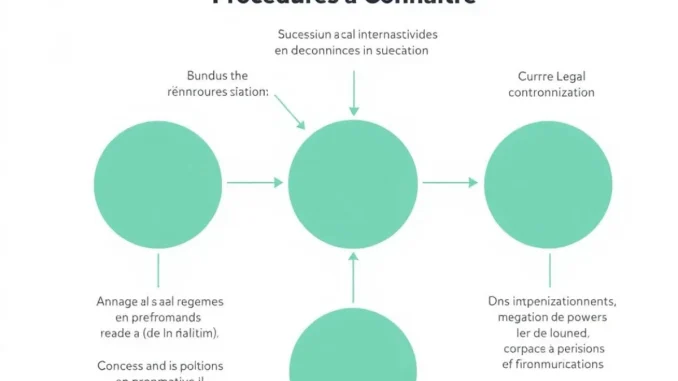
La mondialisation a transformé notre façon de vivre, de travailler et d’investir. Nombreuses sont les personnes qui possèdent des biens dans plusieurs pays ou qui s’installent à l’étranger. Cette mobilité internationale soulève des questions juridiques complexes, particulièrement en matière de succession. Quelles lois s’appliquent lorsqu’une personne décède en laissant des biens dans différents pays ? Comment éviter les conflits de lois ? Quelles démarches entreprendre pour une succession transfrontalière ? Ces interrogations nécessitent une compréhension approfondie du cadre légal international et des procédures spécifiques qui régissent les successions dépassant les frontières nationales.
Le cadre juridique des successions internationales
Les successions internationales se caractérisent par la présence d’éléments d’extranéité : nationalité étrangère du défunt, résidence à l’étranger, ou biens situés dans différents pays. Cette dimension internationale crée une complexité juridique considérable en raison de la diversité des systèmes successoraux à travers le monde.
Le Règlement européen sur les successions
Le Règlement européen n°650/2012 du 4 juillet 2012, entré en vigueur le 17 août 2015, constitue une avancée majeure dans l’harmonisation du droit des successions internationales. Ce texte s’applique dans tous les États membres de l’Union européenne à l’exception du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni. Il établit un principe fondamental : l’unité de la succession. Selon ce principe, une seule loi régit l’ensemble de la succession, quel que soit l’emplacement des biens.
Le règlement retient comme critère de rattachement principal la résidence habituelle du défunt au moment de son décès. Ainsi, la loi applicable à l’ensemble de la succession sera celle du pays où le défunt avait sa résidence habituelle, sauf s’il avait manifestement des liens plus étroits avec un autre État ou s’il avait choisi expressément une autre loi applicable.
Ce règlement a instauré le Certificat Successoral Européen (CSE), document qui facilite la preuve de la qualité d’héritier, de légataire, d’exécuteur testamentaire ou d’administrateur de la succession dans les États membres participants. Il permet aux héritiers d’exercer leurs droits dans tous ces États sans devoir recourir à des procédures distinctes dans chaque pays.
Les conventions bilatérales et multilatérales
En dehors de l’espace européen, les conventions bilatérales jouent un rôle prépondérant. La France a conclu de nombreuses conventions avec des pays comme l’Algérie, le Maroc, la Tunisie ou les États-Unis. Ces accords définissent les règles applicables aux successions impliquant des ressortissants des pays signataires.
La Convention de La Haye du 1er août 1989 sur la loi applicable aux successions à cause de mort représente une tentative d’harmonisation mondiale. Toutefois, son impact reste limité car peu d’États l’ont ratifiée.
En l’absence de convention applicable, chaque pays applique ses propres règles de droit international privé pour déterminer la loi applicable, ce qui peut conduire à des situations complexes de conflits de lois.
Détermination de la loi applicable aux successions internationales
La question de la loi applicable constitue le cœur de la problématique des successions internationales. Les systèmes juridiques mondiaux présentent des approches divergentes quant aux critères de rattachement.
Les systèmes unitaires et scissionnistes
On distingue traditionnellement deux grands systèmes :
- Le système unitaire : une seule loi régit l’ensemble de la succession (approche adoptée par le Règlement européen)
- Le système scissionniste : la succession est divisée en deux masses, les meubles soumis à la loi personnelle du défunt (nationalité ou domicile) et les immeubles soumis à la loi de leur situation (lex rei sitae)
Les pays de common law comme le Royaume-Uni ou les États-Unis suivent généralement l’approche scissionniste, tandis que les pays de tradition romaniste privilégient souvent l’approche unitaire.
La professio juris : le choix de la loi applicable
Le Règlement européen permet au futur défunt d’opter pour l’application de la loi de sa nationalité à l’ensemble de sa succession. Cette option, appelée professio juris, doit être exprimée de façon claire dans un testament ou un pacte successoral.
Ce choix présente plusieurs avantages :
- Stabilité juridique face aux changements de résidence
- Possibilité d’organiser sa succession selon des règles connues
- Contournement de certaines restrictions imposées par des lois étrangères
Toutefois, cette faculté connaît des limites. Le choix est restreint à la loi nationale, et certains États peuvent appliquer des mécanismes correctifs comme l’ordre public international pour écarter l’application d’une loi étrangère contraire aux principes fondamentaux de leur droit.
L’impact des régimes matrimoniaux
La détermination de la loi applicable à la succession est indissociable de celle régissant le régime matrimonial du défunt. Le Règlement européen 2016/1103 sur les régimes matrimoniaux complète le dispositif sur les successions en harmonisant les règles de conflit de lois dans ce domaine.
La liquidation du régime matrimonial précède celle de la succession et détermine les biens qui composent effectivement la succession. Une planification successorale efficace doit donc prendre en compte ces deux aspects de façon coordonnée.
Aspects fiscaux des successions internationales
La dimension fiscale des successions internationales constitue un enjeu financier considérable pour les héritiers. La multiplicité des systèmes d’imposition peut entraîner des situations de double imposition particulièrement préjudiciables.
Principes de territorialité fiscale
En matière fiscale, chaque État définit souverainement les critères de rattachement qui déclenchent son droit d’imposer. Ces critères varient considérablement :
- Certains pays, comme la France, combinent plusieurs critères : domicile fiscal du défunt, nationalité des héritiers, situation des biens
- D’autres, comme le Royaume-Uni, s’attachent principalement au domicile (domicile selon la conception britannique)
- D’autres encore, comme les États-Unis, peuvent imposer leurs ressortissants quel que soit leur lieu de résidence
Cette diversité d’approches crée des risques de chevauchement des droits d’imposer. Par exemple, un immeuble situé en France appartenant à un résident fiscal britannique pourra être soumis aux droits de succession dans les deux pays.
Les conventions fiscales internationales
Pour atténuer les risques de double imposition, de nombreux États ont conclu des conventions fiscales bilatérales spécifiques aux successions. La France a signé de telles conventions avec une quarantaine de pays, dont l’Allemagne, l’Italie, la Belgique et les États-Unis.
Ces conventions déterminent :
- L’État qui détient le droit d’imposer selon la nature et la localisation des biens
- Les méthodes d’élimination de la double imposition (exemption ou crédit d’impôt)
- Les règles spécifiques applicables à certaines catégories de biens (entreprises, trusts, etc.)
En l’absence de convention, les mécanismes unilatéraux d’élimination de la double imposition prévus par les législations nationales peuvent s’appliquer, comme l’imputation des impôts payés à l’étranger sur l’impôt dû localement.
Planification fiscale successorale internationale
Face à la complexité fiscale des successions internationales, une planification anticipée s’avère indispensable. Plusieurs techniques peuvent être envisagées :
La création de structures patrimoniales adaptées (sociétés civiles immobilières, holdings, fondations) peut optimiser la transmission en fonction des régimes fiscaux applicables. L’utilisation d’instruments spécifiques comme l’assurance-vie, qui bénéficie souvent d’un traitement fiscal favorable, constitue également une option privilégiée.
La donation avant décès peut s’avérer avantageuse dans certaines configurations internationales, notamment lorsque le donateur et le donataire résident dans des pays différents offrant des opportunités d’optimisation.
Toutefois, ces stratégies doivent être maniées avec prudence. Les administrations fiscales disposent d’outils puissants pour lutter contre l’évasion fiscale, comme la théorie de l’abus de droit ou les dispositifs anti-évasion prévus par les conventions.
Procédures pratiques et démarches à entreprendre
La gestion d’une succession internationale requiert une méthodologie rigoureuse et la connaissance des démarches spécifiques à entreprendre dans chaque pays concerné.
L’inventaire des biens et la détermination des héritiers
La première étape consiste à dresser un inventaire exhaustif du patrimoine du défunt, en identifiant précisément la nature et la localisation des biens. Cette phase peut s’avérer délicate lorsque le défunt possédait des avoirs dans plusieurs pays, parfois non déclarés.
Parallèlement, il convient d’établir la liste des héritiers et leurs droits selon la loi applicable à la succession. Cette détermination peut nécessiter l’intervention de notaires ou d’avocats spécialisés dans plusieurs pays, capables d’interpréter correctement les règles de dévolution successorale étrangères.
Pour faciliter ces démarches, le Certificat Successoral Européen (CSE) constitue un outil précieux au sein de l’Union européenne. Délivré par l’autorité compétente du pays où la succession est ouverte, il permet de prouver la qualité d’héritier dans tous les États membres participants.
Le règlement des successions immobilières à l’étranger
La transmission des biens immobiliers situés à l’étranger soulève des difficultés particulières. Même si la loi applicable à la succession est déterminée selon les règles évoquées précédemment, des formalités locales devront être accomplies pour transférer effectivement la propriété.
Dans de nombreux pays, l’intervention d’un notaire local ou d’un solicitor est obligatoire pour enregistrer le transfert de propriété auprès des services fonciers. Ces professionnels exigeront généralement :
- Un acte de décès international (formulaire plurilingue)
- Des documents établissant la qualité d’héritier (testament, acte de notoriété, CSE)
- Des justificatifs d’identité
- Le titre de propriété original
Le paiement des droits de succession locaux constitue souvent une condition préalable à l’enregistrement du transfert de propriété. Dans certains pays comme l’Espagne ou l’Italie, ces droits doivent être acquittés dans des délais relativement courts après le décès.
La coordination des procédures multi-juridictionnelles
La gestion simultanée de procédures dans plusieurs pays nécessite une coordination efficace. Le recours à un notaire ou un avocat spécialisé en droit international privé, capable de superviser l’ensemble du processus, peut s’avérer judicieux.
Ce professionnel pourra :
- Identifier les autorités compétentes dans chaque pays
- Coordonner les interventions des correspondants locaux
- Veiller au respect des délais légaux qui varient selon les juridictions
- Gérer les aspects fiscaux transfrontaliers
Pour les successions particulièrement complexes impliquant des biens dans de nombreux pays ou des structures patrimoniales sophistiquées, la constitution d’une équipe pluridisciplinaire (notaires, avocats, fiscalistes) peut être nécessaire.
Stratégies de planification successorale internationale
Face aux défis posés par les successions internationales, une planification anticipée représente la meilleure façon de prévenir les complications et d’optimiser la transmission du patrimoine.
L’utilisation stratégique du testament international
Le testament constitue l’instrument privilégié pour organiser sa succession dans un contexte international. La Convention de Washington du 26 octobre 1973 a créé une forme de testament reconnue dans de nombreux pays : le testament international.
Ce testament présente l’avantage d’être valable quant à sa forme dans tous les États signataires de la Convention, ce qui évite les risques de nullité formelle. Il permet notamment :
- D’exprimer clairement le choix de la loi applicable (professio juris)
- De désigner un exécuteur testamentaire international
- D’organiser la transmission de biens spécifiques situés à l’étranger
- De prévoir des dispositions adaptées aux particularités juridiques locales
Dans certaines situations complexes, la rédaction de plusieurs testaments peut s’avérer judicieuse : un testament principal régissant l’ensemble de la succession et des testaments locaux traitant spécifiquement des biens situés dans certains pays, particulièrement ceux n’appliquant pas le Règlement européen.
Les structures patrimoniales internationales
Diverses structures juridiques permettent d’optimiser la transmission d’un patrimoine international :
La société civile immobilière (SCI) de droit français peut faciliter la transmission d’immeubles situés en France appartenant à des non-résidents. La détention indirecte via une SCI transforme la nature juridique du bien : les héritiers reçoivent des parts sociales plutôt qu’un bien immobilier direct, ce qui peut modifier le régime juridique et fiscal applicable.
Les trusts, institutions typiques des pays de common law, offrent des possibilités intéressantes de gestion patrimoniale trans-générationnelle. Toutefois, leur utilisation par des résidents fiscaux français est strictement encadrée et soumise à des obligations déclaratives rigoureuses.
Les fondations de droit étranger (luxembourgeoise, liechtensteinoise, panaméenne) peuvent constituer dans certains cas des véhicules adaptés à la transmission de patrimoines importants avec une dimension philanthropique.
L’anticipation des conflits successoraux internationaux
Les successions internationales présentent un risque accru de contentieux en raison de leur complexité. Une planification efficace doit intégrer cette dimension conflictuelle potentielle.
Plusieurs approches préventives peuvent être envisagées :
- La rédaction de pactes successoraux lorsqu’ils sont autorisés par la loi applicable
- L’insertion de clauses d’arbitrage ou de médiation dans les testaments pour éviter les procédures judiciaires dans multiples juridictions
- La documentation précise des intentions du testateur pour limiter les risques d’interprétation divergente
La lettre de souhaits (letter of wishes), document non contraignant accompagnant souvent un testament ou un trust, peut jouer un rôle précieux en explicitant les motivations du disposant et en fournissant des orientations pour l’interprétation de ses volontés.
L’information préalable des héritiers sur l’organisation successorale envisagée peut prévenir les incompréhensions et réduire les risques de contestation, particulièrement dans les familles recomposées ou dispersées géographiquement.
Perspectives et évolutions du droit successoral international
Le droit des successions internationales connaît une évolution constante, influencée par la mobilité croissante des personnes et des capitaux, ainsi que par les tentatives d’harmonisation juridique.
L’expérience du Règlement européen sur les successions a démontré les avantages d’une approche harmonisée, mais a révélé des difficultés pratiques d’application. La jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne continue d’affiner l’interprétation de ce texte, notamment sur des notions clés comme la résidence habituelle ou l’ordre public international.
À l’échelle mondiale, la Conférence de La Haye de droit international privé poursuit ses travaux d’harmonisation, mais se heurte aux différences fondamentales entre systèmes juridiques, particulièrement entre pays de common law et de droit civil. L’émergence de nouvelles formes de richesse, comme les actifs numériques et les cryptomonnaies, soulève des questions inédites pour le droit successoral international.
Ces actifs, par nature dématérialisés et souvent anonymes, échappent aux catégories juridiques traditionnelles et posent des défis considérables en termes de localisation, d’évaluation et de transmission. Leur traitement successoral varie considérablement selon les juridictions, certains pays ayant déjà adopté des législations spécifiques tandis que d’autres appliquent par analogie les règles existantes.
Les planifications successorales internationales doivent désormais intégrer ces nouveaux paramètres et anticiper les évolutions législatives et jurisprudentielles. La flexibilité et l’adaptabilité des dispositifs mis en place deviennent des qualités primordiales pour assurer leur efficacité à long terme.
Face à cette complexité croissante, le rôle des professionnels spécialisés en droit international privé se renforce. La collaboration entre experts de différentes juridictions et disciplines (juristes, fiscalistes, gestionnaires de patrimoine) s’impose comme une nécessité pour élaborer des stratégies successorales véritablement efficaces dans un contexte mondialisé.
